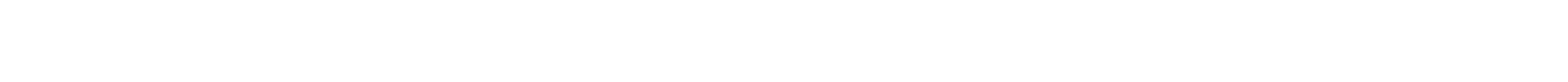Le cancer frappe toutes les catégories d’âge. Pour Rita V., l’annonce arrive à un moment où elle s’apprête plutôt à savourer une retraite bien méritée et à profiter des plaisirs de la vie. En septembre 2009, une banale prise de sang montre un taux de globules blancs anormalement élevé. Des examens complémentaires révèlent que Rita est atteinte d’une leucémie lymphoïde chronique (LLC). À ce stade initial de la maladie, la LLC ne nécessite aucun traitement. Seul un suivi régulier s’avère indispensable. « Quand j’ai appris que je souffrais de ce cancer, la vie s’est arrêtée. Je n’arrivais plus à avoir de projets. Je ne voyais pas d’issue. La consigne était ‘’ wait and watch ‘’ (attendre et surveiller), mais pour moi, c’était devenu ‘’ wait and worry‘’ (attendre et s’inquiéter)».
Dix ans d’attente
Les premières années, Rita ne ressent aucun symptôme, à part une grande fatigue. Voyant les chiffres des globules blancs augmenter, le cancer commence à devenir une réalité, ce qui la ronge d’inquiétude. Elle cherche alors à comprendre sa maladie. « Savoir en quoi consiste précisément ce cancer comblait mon besoin de le maîtriser », explique-t-elle. Elle se documente et multiplie les recherches sur Internet, à travers les sites spécialisés, les blogs scientifiques et les forums de communautés de patients. C’est ainsi qu’elle identifie un éminent spécialiste, Professeur à Londres, qui la met en contact avec la Professeure Dominique Bron, de l’hôpital Jules Bordet. Celle-ci suit Rita depuis lors.
Pendant plus de 10 ans, Rita vit avec l’espoir qu’un traitement puisse un jour venir à bout de son cancer. « On passe par toutes les phases de découragement. Heureusement, j’ai été très bien entourée, ajoute-t-elle. Mon médecin de famille a été constamment présent. Mes amis m’ont aidée à garder la tête hors de l’eau. Tout cela était d’autant plus difficile car je me retrouvais pensionnée. Je n’avais plus mon environnement de travail, mes collègues, mes obligations, ce qui vous permet de penser à autre chose ». En plus de sa passion pour le jardinage, Rita a beaucoup surfé sur le web : « Internet est un formidable outil si l’on s’en sert bien. J’ai pu me documenter sur ma maladie, lister les questions à poser à mon médecin, mais aussi rejoindre des groupes de patients souffrant de la LLC aux quatre coins du monde. Je me suis alors sentie mieux comprise, et moins seule».
Un traitement miracle
En 2019, la maladie progresse rapidement. Rita souffre d’épuisement, de vertiges, de nausées, de bouffées de chaleur et des ganglions apparaissent. Ses globules blancs augmentent à une vitesse inquiétante. Devant ces symptômes, la Professeure Bron décide de démarrer un traitement en janvier 2020. Plutôt qu’une chimiothérapie classique, aux effets secondaires potentiellement lourds, Rita a la chance de recevoir un tout nouveau traitement : une combinaison d’anticorps associés à un inhibiteur d’enzymes très efficace.
Après avoir scrupuleusement suivi toutes les étapes, Rita voit enfin le bout du tunnel et ose à peine y croire. L’évolution de son cancer semble stoppée. Mieux : les analyses ne montrent plus aucune trace de la maladie. L’espoir renaît. « Aujourd’hui, j’ai la possibilité de regarder plus loin, se réjouit-elle. Ce traitement m’a rendu la vie. Ce médicament n’est pas un simple médicament. Comme me l’a dit la Professeure Bron, dans mon cas, c’est de l’or ! ».
Merci la recherche !
Aujourd’hui, Rita savoure ce retour à une vie quasi normale, même si le contexte du coronavirus l’empêche encore d’en profiter à 100 % à cause de son immunité très basse. « Je suis émerveillée par ce que la science peut faire et par les avancées fulgurantes réalisées en quelques années, s’exclame-t-elle. Je suis la preuve que l’on ne doit jamais perdre espoir face au cancer, quel que soit son âge. Des progrès ont lieu continuellement. Ce qui a été possible aujourd’hui ne l’était pas quand mon diagnostic a été posé ».
Outre les percées scientifiques, Rita tient à souligner l’importance capitale du soutien psychologique dont elle a eu la chance de bénéficier. Ses docteurs et son entourage lui ont été d’une immense aide face à la maladie. « J’ai pu tenir le coup grâce à mes amis. S’ils n’avaient pas été là, j’aurais certainement souhaité recevoir un accompagnement extérieur. C’est indispensable car on ne guérit pas seul. Au-delà du cancer, il faut reconnaître que la plupart des médecins ont beaucoup évolué dans leurs relations avec les patients. Ces derniers ne sont pas des cobayes ou des numéros. Avec la Professeure Bron, j’ai eu la chance de bénéficier d’une écoute de tous les instants. À chaque étape, elle m’a expliqué, elle m’a informée, m’a rassurée et m’a encouragée. Elle m’a apporté le meilleur traitement et assuré le meilleur suivi. Nous avons développé une approche constructive, et du coup, rassurante. Quand la science rencontre l’humanité, on assiste à des miracles».
Plume : Catherine Frennet