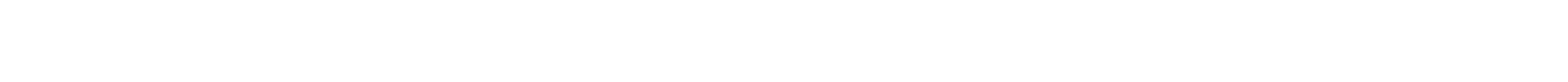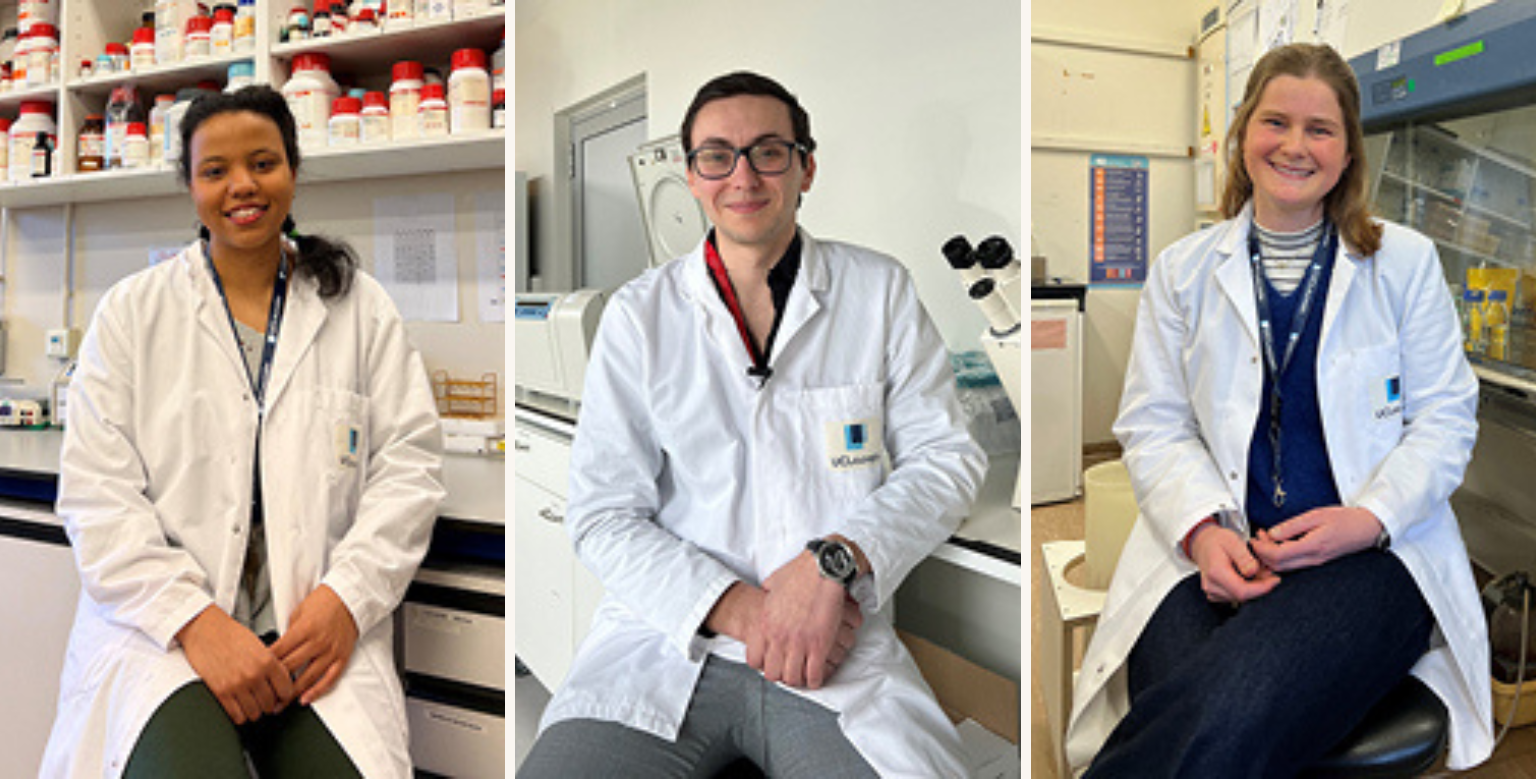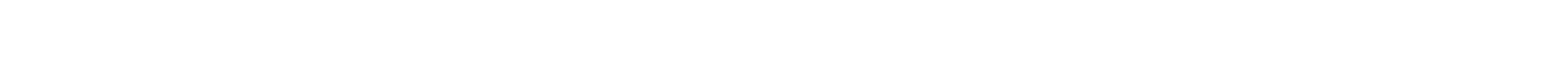77 000 nouveaux cas de cancer de la peau seraient détectés en 2030, selon la Fondation contre le Cancer. C’est le cancer touchant le plus de personnes au monde, mais aussi en Belgique et les chiffres ne cessent de grimper.
Avant ses 75 ans, un Belge sur cinq sera confronté à un cancer de la peau. Ces chiffres viennent de la Fondation contre le Cancer, qui alerte sur le nombre de cas de ce type de cancer, qui ne cesse de grimper.
Environ 40 % de tous les cancers détectés aujourd’hui sont des cancers de la peau, ce qui en fait le type de cancer le plus fréquent dans le monde et en Belgique.
Selon la Fondation, le nombre de nouveaux cas en Belgique est passé de 11 000 en 2004 à 50 000 en 2024, avec une projection de 77 000 d’ici à 2030.
Importance de la prévention contre les rayons UV
« Une grande partie des cancers de la peau peut être évitée en se protégeant correctement contre les rayons UV », explique la Fondation dans un communiqué.
Mais de nombreuses personnes restent mal informées sur les mesures de protection efficaces. La Fondation contre le Cancer affirme que, par rapport à 2021, les Belges sont moins bien informés sur les mesures préventives.
Par exemple, 77 % des Belges savent qu’une seule application de crème solaire par jour ne suffit pas. Ils sont seulement 64 % à savoir qu’il est possible d’attraper un coup de soleil en étant à l’ombre.
Parmi les personnes les moins bien informées, on trouve « les jeunes et les hommes » et « les plus de 44 ans sont nettement mieux informés que les moins de 35 ans ».
Comportement face aux coups de soleil
Le taux de coups de soleil chez les adultes et les enfants reste très élevé. En 2023, 77,5 % des jeunes de 16 à 24 ans ont déclaré avoir eu des coups de soleil, dont 27 % des coups de soleil graves, entraînant des cloques, des frissons, de la fièvre et des nausées.
Et en tout, c’est 10 % de la population qui a attrapé un coup de soleil grave. Ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2011, où seulement 2 % des Belges souffraient de coups de soleil graves.
Selon une étude des National Institutes of Health, des instituts nationaux de santé, attraper cinq coups de soleil sévères entre 15 et 20 ans augmente de 80 % le risque de mélanome.
Une tendance qui n’a pas l’air d’inquiéter les Belges de moins de 44 ans puisque « 1 personne interrogée sur 3 déclare préférer attraper un coup de soleil plutôt que de rentrer de vacances sans avoir bronzé ».
Risques pour les travailleurs en extérieur
Environ 25 % des Belges travaillent à l’extérieur, et parmi eux, un sur trois passe plus de cinq heures par jour au soleil. Ils sont davantage exposés aux rayons UV et ont plus de risques d’attraper un cancer de la peau.
Ils sont 27 % à être gravement brûlés par le soleil. Pourtant, les travailleurs en extérieur ont une moins bonne connaissance des dangers du soleil et des mesures de prévention que le Belge moyen.
Pour reprendre le même exemple que tout à l’heure, 63 % savent qu’une seule application de crème solaire par jour ne suffit pas. Ils sont aussi 52 % à savoir qu’il est possible d’attraper un coup de soleil en étant à l’ombre.
Face à l’augmentation préoccupante des cas de cancer de la peau, la Fondation contre le Cancer souligne l’importance de la prévention et du dépistage pour réduire l’incidence de cette maladie.
Crédits : RTL Info