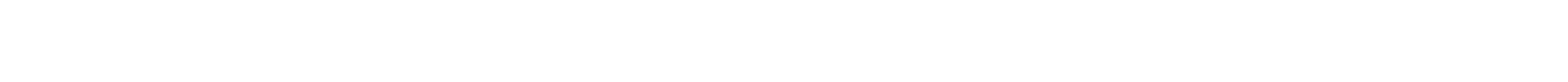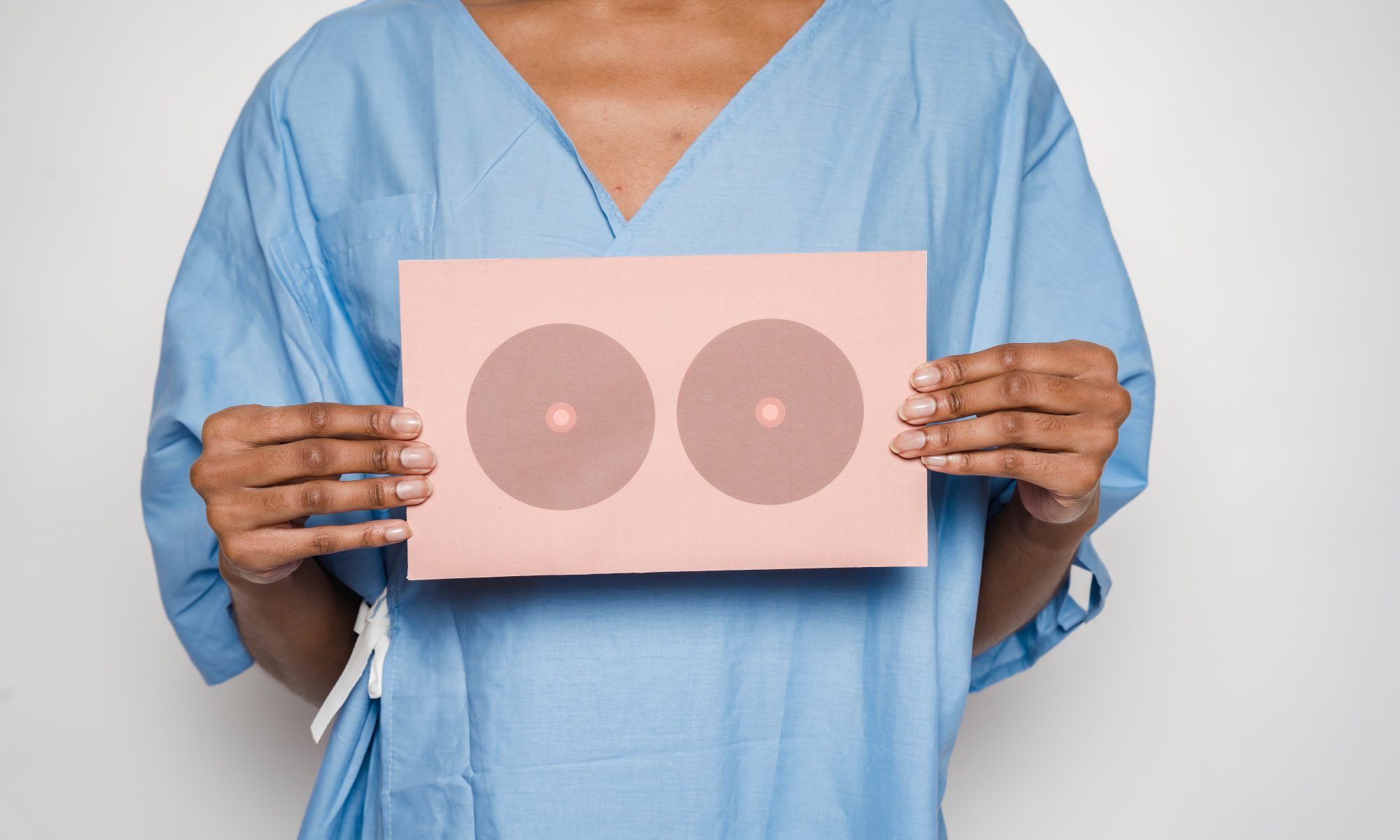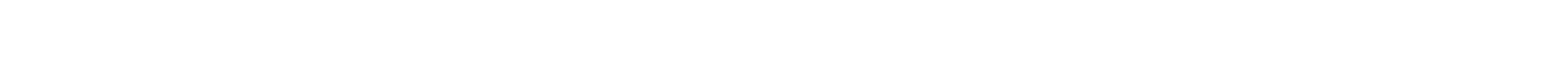La troupe du Télévie en folie a sillonné la Wallonie pendant trois semaines à votre rencontre ! De Charleroi, en passant par Marche-en-Famenne, pour finir à Malmedy, vous avez été presque 9 000 à assister au spectacle et à les soutenir pour la recherche contre le cancer.
Ce n’était pas un exercice facile, mais ils et elles l’ont fait ! Les animateurs, animatrices et journalistes de RTL sont montés sur les planches de trois grandes salles wallonnes pour amuser et faire rire le public venu en nombre pour les supporter.
L’origine du Télévie en folie
L’idée du Télévie en folie prend sa source lors d’une discussion entre Géraldine Gautier, responsable des évènements à RTL Belgium, et Olivier Leborgne, metteur en scène et humoriste, afin de renouveler la pièce de théâtre, ancien spectacle au profit du Télévie.
Cette année, pour la deuxième saison, l’équipe de RTL a vu les choses en grand. Après le succès de la première édition, la troupe est repartie pour une tournée qui mélange humour, émotions et musique. Ce n’est plus une date qui était prévue mais trois, à Charleroi, Marche-en-Famenne et Malmedy, avec 4 représentations, de quoi satisfaire le plus grand nombre.
Un sentiment de joie
L’émotion qui ressort le plus lorsque l’on pose la question aux animateurs, animatrices et journalistes à la sortie de la scène est la joie. À chaque date, peu importe le lieu, le public les soutenait et riait avec elles et eux.
« Faire rire un public, c’est l’une des sensations les plus folles qui existe » Caroline Fontenoy
Ils étaient onze à s’essayer à l’humour et à faire face au public : Sandrine Dans, Olivier Schoonejans, Sophie Pendeville, Sandrine Corman, Olivier Leborgne, Anne Ruwet, Thomas de Bergeyck, Emilie Dupuis, Luc Gilson, Caroline Fontenoy et Jacques van den Biggelaar.
Les premiers pas sur scène à Charleroi étaient stressants pour certains et certaines comme Emilie et Thomas qui appréhendaient ce premier passage. Un sentiment dominait à la sortie : le soulagement. « On se demandait si on était comiques, si ça allait bien se passer, mais avec les rires et l’énergie du public, ça nous a portés. Ce qui est génial, et on ne s’y attendait pas du tout, c’est que le public a ri des mimiques de visage et des silences », conclut le duo.
Le public ravi
À Charleroi, le Dôme était rempli et les spectatrices et spectateurs ravis. « C’est une belle soirée, un beau spectacle. J’ai aimé tous les sketchs. Avant, c’étaient des pièces de théâtre, mais c’est bien comme ça aussi, c’est chouette », « Je suis très contente d’être là, je trouve le début de soirée très sympa », « Une soirée super sympa, c’est vraiment très gai et en plus, c’est pour la bonne cause » peut-on entendre à l’entracte.
Un public qui a comblé Sandrine Corman et Sophie Pendeville : « C’était trop bien cette première, le public était en feu. C’était génial de partager un moment tous ensemble, comme ça, avec un public de folie ! ».
« Je suis mort, mais la récompense, ce sont les rires du public et ça, c’était extraordinaire ! » Olivier Schoonejans
Deuxième date, sold out à Marche-en-Famenne. Les artistes ont senti l’ambiance de folie qui régnait. « On commence vraiment à s’approprier les personnages donc c’est génial, en plus le public est très, très bien » confie Luc Gilson. Son homologue du journal télévisé ne tarit pas d’éloges non plus : « Le sketch devait durer quatre minutes, mais le public était tellement réactif, que ça en a duré dix. On s’est éclatés, on s’est bien amusés ! ».
Côté public, le sourire est sur les lèvres : « J’ai trouvé ce spectacle génial, c’est la première fois et, à mon avis, je reviendrai ! Je donne 10/10 ».
Le public de Malmedy était tout aussi participatif, les deux représentations du jour ont épuisé nos artistes qui se sont reposés après avoir fait la fête pour célébrer la fin de tournée !
Une organisation millimétrée
Le Télévie en folie est une véritable fourmilière, chaque week-end, des dizaines de personnes ainsi que leur matériel est à acheminer à bon port. Géraldine nous a partagé une anecdote : le néon du logo du Télévie en folie, qui est suspendu au fond de la scène, a cassé deux fois en trois week-ends ! Elle nous confie qu’il faut une organisation à toute épreuve pour le déplacer. La veille de la dernière représentation, au soir, les équipes étaient encore occupées à le réparer…
Au fur et à mesure des représentations, la confiance est montée et les pas sur scène étaient plus assurés. La tournée a pris fin, mais n’aurait pas eu ce succès sans toutes les personnes de l’ombre qui travaillent dessus : les techniciens, les coiffeuses et maquilleurs, la régisseuse, les bénévoles, etc.
Et alors, c’est quoi la suite ?
Olivier Leborgne revient sur ces trois dates en tant que metteur en scène et interprète et tient à féliciter toutes les personnes présentes. « C’était une formidable équipe, avec les animateurs, Mister Cover, Manon, les chanteurs, les danseurs de 2MAD, toute l’équipe technique, il y a vraiment beaucoup de monde qui met son énergie positive à faire que ce soit une grande fête, un grand partage avec le public. En plus, le public a réagi magnifiquement bien, tout ça pour le Télévie. On est partis pour une troisième édition ? » conclut-il en laissant planer un doute.
Valentine Jonet