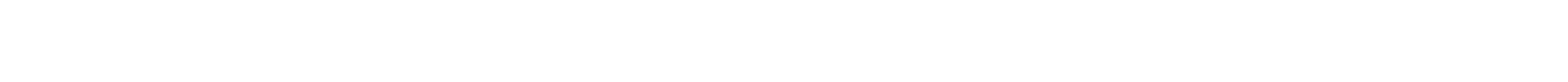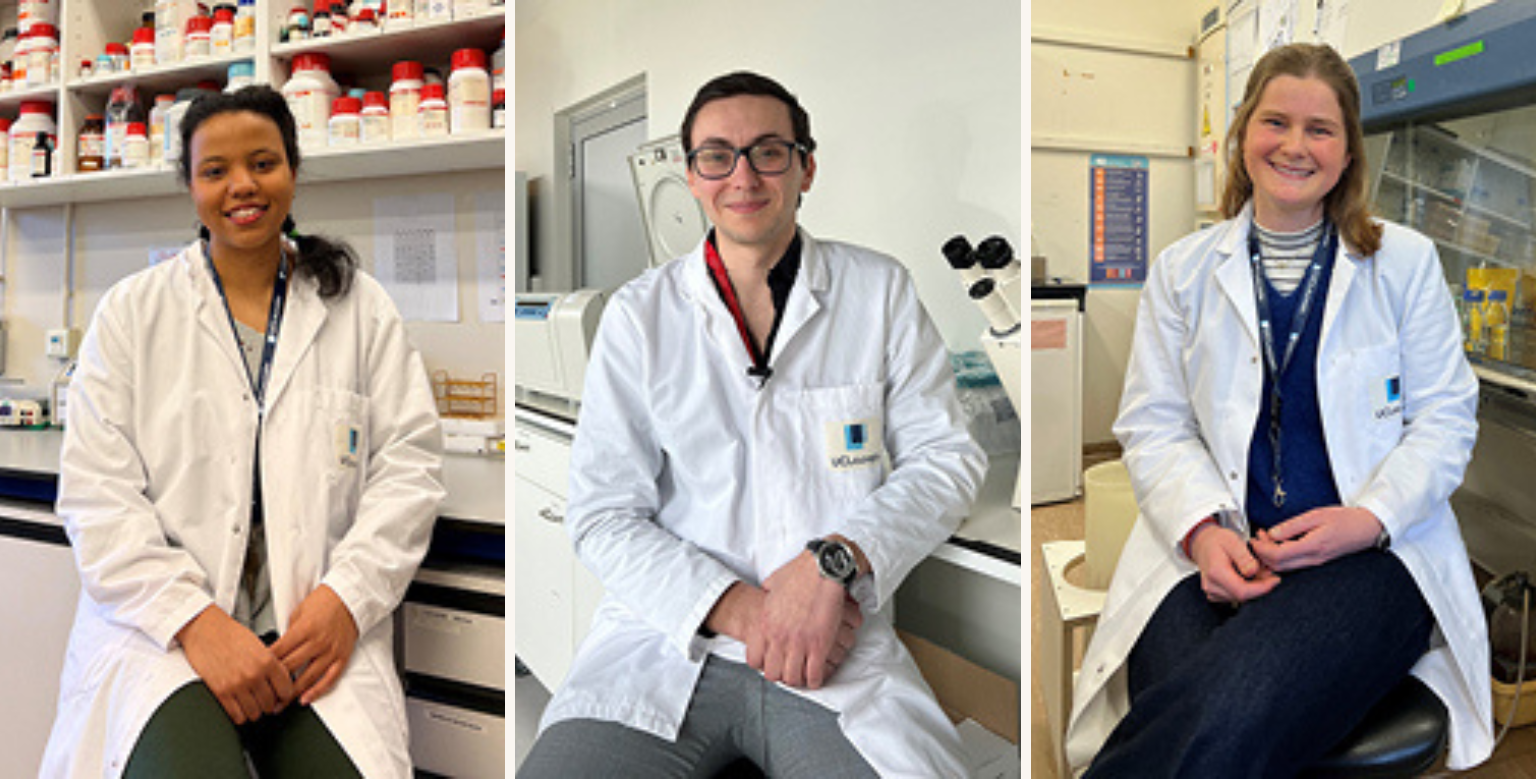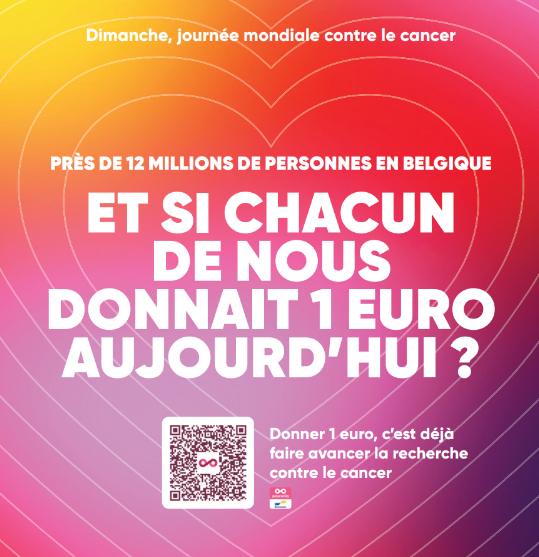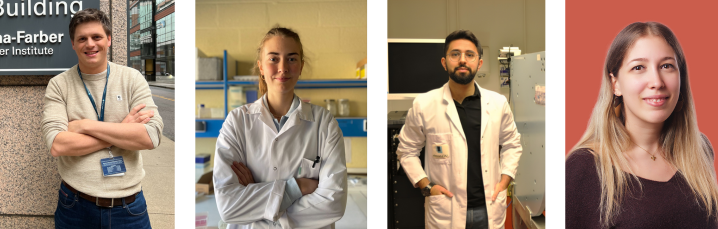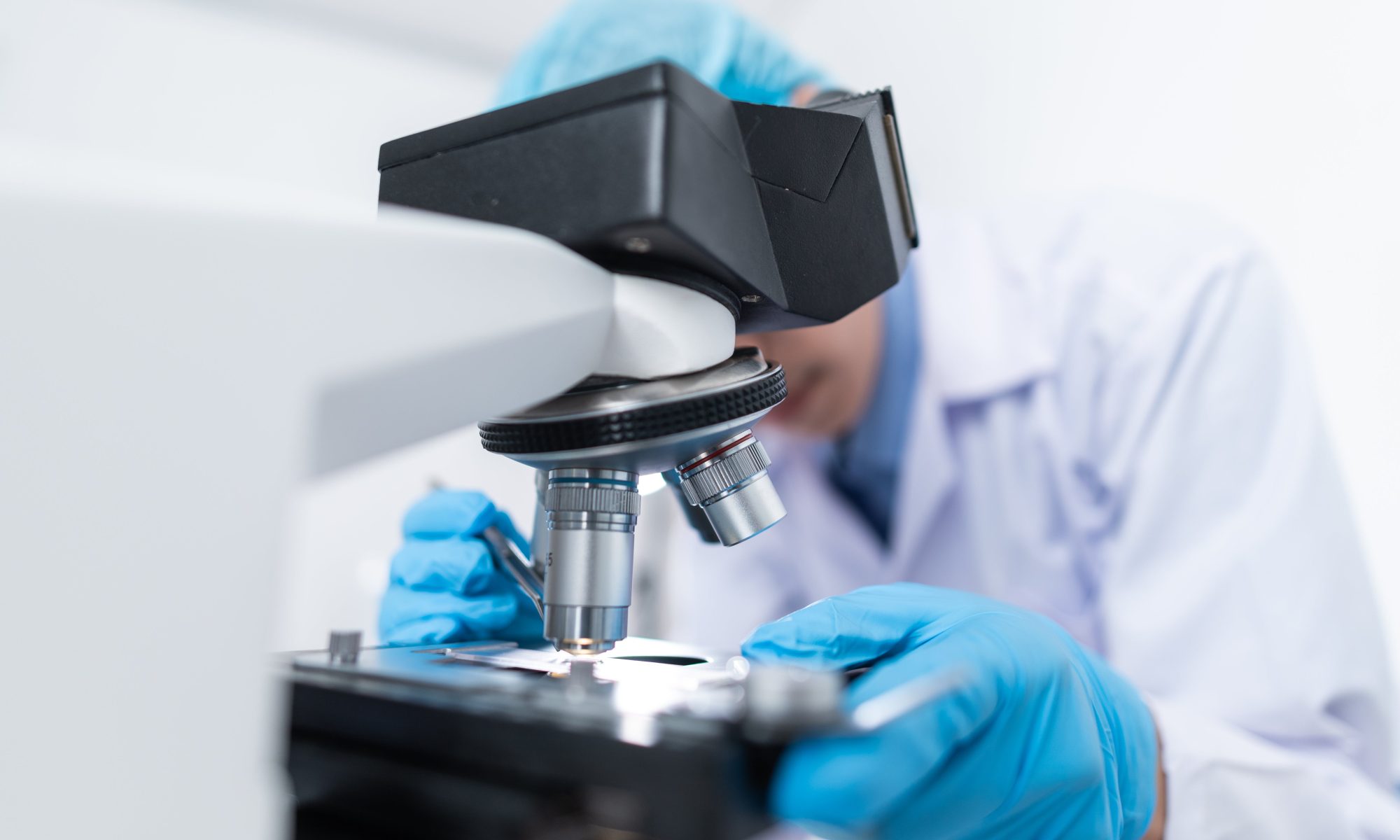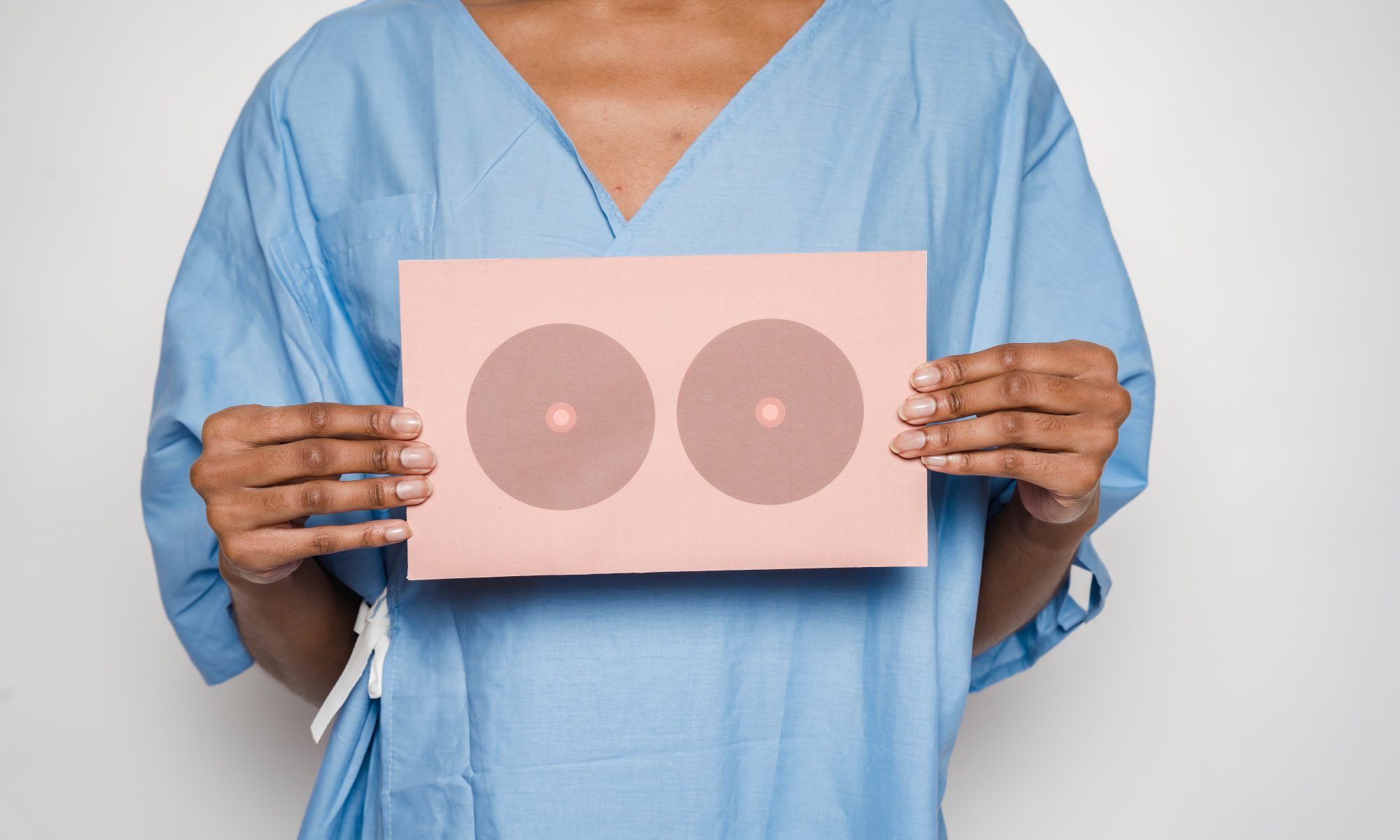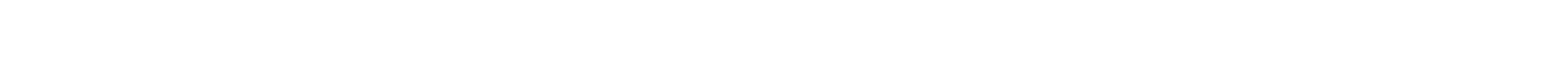Cette année encore, de nouveaux thèmes de recherche sont apparus. Et, grâce au Télévie, de nouveaux chercheurs vont pouvoir faire, selon la modeste expression de l’un d’entre eux, « quelques pas de plus ». Pleins feux sur Pierre Foidart, Inès Bouriez, Mohammad Wehbi et Charlotte Grégoire.
Pierre Foidart : « Être à la fois clinicien et chercheur, c’est ça qui me rend heureux ! »
Après avoir passé quatre ans comme chercheur postdoctorant à Boston, dans un des plus grands centres mondiaux de recherche sur le cancer, le Dana-Farber Cancer Institute, Pierre Foidart est de retour au GIGA de l’ULiège.
Pierre Foidart a découvert l’oncologie pendant ses études de médecine. « Dès que j’ai pu assister à des consultations au CHU, j’ai été fasciné, d’une part, par l’aspect intellectuel de l’oncologie médicale – avec le cancer, il faut toujours avoir un coup d’avance, ce qui oblige les oncologues à une compréhension de plus en plus poussée de ses mécanismes physiopathologiques et des stratégies thérapeutiques – et, d’autre part, par la dimension psychique et relationnelle propre à ce métier profondément humain. »
C’est le Professeur Guy Jerusalem, à qui il présente sa candidature, qui l’incite à réaliser, parallèlement à sa formation clinique, une thèse de doctorat sur le – ou plutôt les, en raison de leur hétérogénéité – cancers du sein triple négatif. « Avec des périodes alternées de six mois en clinique et six mois en laboratoire. Je n’ai d’abord voulu m’engager que
pour six mois : je n’étais pas certain que j’aimerais la recherche. Mais Guy Jerusalem avait raison : être à la fois clinicien et chercheur, c’est cette vie-là qui me rend heureux ! »
Doublement de génome
Après avoir défendu sa thèse en 2019, il a eu l’occasion d’aller travailler à Boston, au Dana Farber Cancer Institute. « Comme j’avais le sentiment de devoir passer quelques années à l’étranger pour grandir en tant que chercheur, j’ai décidé de suspendre mon assistanat ». Une décision qu’il n’a jamais regrettée. « J’ai continué à travailler sur les cancers du sein triple négatif, mais en m’intéressant à la réponse immunitaire à ces cancers et à la manière dont ils tentent d’y échapper en doublant leur génome. Une tumeur qui présente un doublement de génome répond différemment au système immunitaire, mais aussi aux traitements d’immunothérapie. »
Nouvelles cibles
« Désormais revenu au GIGA, je vais pousser plus loin la compréhension de ce lien immunitaire. C’est à cela que va servir le financement du Télévie : décrypter la biologie moléculaire des tumeurs avec un doublement de génome et leurs réponses au système immunitaire et aux immunothérapies, et si possible identifier de nouvelles cibles thérapeutiques spécifiques à ces tumeurs. En collaboration avec Boston, bien entendu, mais aussi avec d’autres labos belges… ». Tout en prenant, à 34 ans, le temps nécessaire pour terminer son assistanat : il lui reste encore un an de formation clinique avant de décrocher son diplôme d’oncologue médical !
Inès Bouriez : « Mon mémoire m’a donné le déclic »
À 25 ans, Inès Bouriez est passionnée par le vieillissement et ses rapports avec les cancers en général, et les cancers cutanés en particulier. Le financement du Télévie, dont elle bénéficie depuis quelques semaines, lui apparaît d’abord comme une forme de reconnaissance : « Ça prouve que le projet a du potentiel ! » Dans la liste des sujets de mémoire proposés aux étudiants de master en biochimie et biologie moléculaire à l’UNamur, Inès a flashé sur « L’influence du sécrétome des kératinocytes sénescents sur le développement du cancer cutané ». « Les cancers cutanés sont de plus en plus fréquents, et ce n’est pas seulement dû à l’exposition au soleil, mais aussi au vieillissement de la population. Plus on avance en âge, plus on risque d’en développer un. La question étant : pourquoi ? »
Réponse(s)
Son mémoire lui a apporté un embryon de réponse : quand elles vieillissent, les cellules de la peau ou kératinocytes produisent un sécrétome (ensemble de molécules) pro-inflammatoire, qui pourrait bien faciliter la migration et la transformation des cellules cancéreuses et les rendre plus agressives. « Mais j’ai également découvert que j’adorais travailler en laboratoire, tester, voir ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas, réfléchir, créer des projets et les présenter… Avant, je n’aurais jamais pensé à faire de la recherche. C’est vraiment mon mémoire qui m’a donné le déclic ! »
Trio idéal
Aussi a-t-elle accueilli avec enthousiasme l’idée de le prolonger e doctorat. D’autant que sa promotrice principale, Florence Chainiaux, Chercheuse qualifiée FNRS à l’UNamur, est spécialisée, un de ses copromoteurs, Yves Pournay, Professeur à l’UNamur, dans la biologie cutanée, et l’autre, Cédric Blanpain, Professeur à l’ULB, dans le cancer, dans le cancer. « Je ne pourrais pas être mieux suivie : c’est le trio idéal ! » Un stage au Centre de recherche du CHUM à Montréal, dans un laboratoire travaillant sur le lien sénescence-cancer, l’a d’ailleurs confortée dans son objectif : « Identifier les facteurs qui favorisent le développement d’un cancer de la peau dans l’environnement vieillissant, afin de les éradiquer ».
Finalité
Faut-il en conclure qu’elle apprécie surtout la recherche pour son utilité pratique ? « La recherche fondamentale, c’est passionnant. Mais, ce qui m’a plu, dans ce projet, c’est la finalité appliquée. Si je peux contribuer, si peu que ce soit, à la lutte contre le cancer, ça me rendra très heureuse… »
Mohammad Wehbi : « C’est un projet interdisciplinaire. Et moi, j’ai fait un peu de tout… »
Détenteur d’une licence de biochimie de l’Université Libanaise, à Beyrouth, et d’un master en génie biomédical de l’Université de Grenoble Alpes, Mohammad Wehbi, originaire du Liban, est aujourd’hui, à 24 ans, Doctorant à l’UCLouvain, au Louvain Drug Research Institute, où il se consacre à la détection du mélanome.
On pense souvent que le mélanome, c’est facile à détecter : il suffit d’une biopsie ! « Bien sûr. Mais une biopsie, c’est une chirurgie. » Son projet porte donc sur la détection précoce et précise du mélanome sans chirurgie.
Épaisseur de Breslow
« Le mélanome est le cancer de la peau le plus dangereux, en constante augmentation ces derniers temps. Les mélanocytes, cellules à l’origine du mélanome, contiennent un pigment appelé mélanine, responsable de la pigmentation de nos cheveux, de notre peau et de nos yeux. Et le premier critère de gravité d’un mélanome est son épaisseur de Breslow, mesurée en millimètres depuis la couche épidermique jusqu’à la partie la plus profonde, dans le derme, corrélée à une quantité anormale de mélanine dans la tumeur. »
Mélanine paramagnétique
Le défi est de valider une technique non invasive, renseignant à la fois sur la quantité de mélanine et la profondeur de Breslow. « En fait, la mélanine présente une propriété spécifique, qui est d’être paramagnétique. Ce qui signifie qu’elle peut être détectée par une technique appelée résonance paramagnétique électronique ou RPE. Une étude clinique sur la RPE dans le mélanome a montré que cette technique est capable de distinguer une tumeur bénigne d’une tumeur maligne avec un niveau de confiance élevé. Mais, pour mesurer la profondeur de Breslow, et donc évaluer la gravité de la tumeur, il faut utiliser un mode amélioré de RPE, l’analyse multiharmonique. »
RPE contre biopsie
Cette technique améliorée ayant fait ses preuves in vivo, sur la peau des souris, les tumeurs ganglionnaires et les métastases pulmonaires, Mohammad prévoit, pour les deux prochaines années, un essai clinique sur 183 patients, afin d’évaluer les performances de la RPE clinique et multiharmonique, par rapport à la biopsie, pour le diagnostic du mélanome cutané. « C’est un projet interdisciplinaire, qui combine biologie, physique- chimie, ingénierie et recherche clinique. Comme j’ai fait un peu de tout, ça me convient très bien. Et j’espère ainsi augmenter la spécificité du diagnostic et accélérer la prise en charge du mélanome avancé. »
Charlotte Grégoire : « Ce que j’aime vraiment, c’est la psycho-onco ! »
Après des études en psychologie clinique à l’ULiège, un mémoire sur les conjoints des personnes atteintes d’un cancer et une thèse de doctorat sur l’utilisation de l’autohypnose et de l’autobienveillance en oncologie, Charlotte Grégoire, 32 ans, relève un nouveau défi.
Ce n’est pas la première fois que Charlotte fait appel au Télévie. « Après avoir défendu ma thèse, en avril 2020, j’ai postulé à plusieurs bourses de postdoctorat. Et, en attendant les résultats, j’ai travaillé au CHU, en oncologie médicale, en tant que gestionnaire de projets. J’ai obtenu un premier financement Télévie pour un projet portant sur trois interventions complémentaires – l’hypnose, la méditation d’auto-compassion et une nouvelle technique appelée la transe cognitive auto-induite, issue des pratiques chamaniques traditionnelles – destinées à améliorer la qualité de vie des patients oncologiques. Ce projet, mené sur le terrain par une doctorante, Nolwenn Marie, et supervisé par moi, ainsi que par les Docteures Vanhaudenhuyse et Gosseries, est toujours en cours. »
Cluster
Mais c’est pour un autre projet, intitulé « Évolution et prise en charge d’un ensemble, un groupe de symptômes psychoneurologiques chez les patients ayant eu un cancer du sein ou un cancer digestif » que le Télévie lui a accordé, cette année, un deuxième financement. « Les patients oncologiques présentent différents symptômes fréquents et sévères, étroitement liés les uns aux autres : fatigue, troubles du sommeil, douleur, détresse émotionnelle, difficultés cognitives… L’idée du projet est de mieux comprendre les relations entre ces symptômes au moyen de ce qu’on appelle des analyses en réseaux, afin de déterminer un symptôme central, susceptible de devenir une cible privilégiée pour agir sur l’ensemble de ces symptômes. Cette évaluation va se faire en deux ans, sur 500 patients au total – 250 avec un cancer du sein, 250 avec un cancer digestif. Et, dans une deuxième phase, pour laquelle il me faudra un nouveau financement, nous viserons ce symptôme central, par des interventions complémentaires non pharmacologiques, pour étudier son impact sur tout le groupe de symptômes. »
Challenge
Si son passage au CHU de Liège l’a éclairée sur ses préférences – « ce que j’aime vraiment, c’est l’oncologie, et surtout la psycho-onco, la dimension psychologique de l’oncologie » – et sur son désir de rester chercheuse – « même si ça implique de chercher tout le temps de nouveaux financements, c’est très challengeant ! », elle reconnaît elle-même qu’elle est trop speed pour s’adonner à la relaxation, à la méditation, ou même à l’hypnose, malgré son admiration pour la Professeure Marie-Élisabeth Faymonville, dont elle a suivi les cours.
« Mais ça ne m’empêche pas de constater que ces approches aident vraiment les patients – et c’est ça l’important. »
Marie-Françoise Dispa
Le Télévie News 11 est sorti et est disponible sur notre site televie.be